15/02/2012
Une expérience extraordinaire (Jan HEUFT) 2
Vivre ailleurs ( Suite )
En septembre 78 je commençais une nouvelle aventure à l’école paramédicale de Parnet à Alger et l’Ecole de Jeunes Sourds d’El Harrach. Quelle ne fut pas mon heureuse surprise en découvrant que mon premier responsable était Monsieur Bacha, cousin de notre célèbre Bacha Mustapha, ancien élève de Beni-Yenni et originaire de Bou Adenane. Après avoir obtenu le diplôme d’Etat de Maître Spécialisé pour Handicapés Auditifs, je me suis entièrement consacré à cette tranche de population. Ce fut un nouveau défi et une nouvelle aventure mais aussi riches que ma première étape dans les montagnes du Djurdjura. L’état Algérien m’a demandé, pendant plus de trente ans, de préparer des élèves, sourds et muets, aux examens du Certificat d’étude, de la sixième au Brevet, à l’entrée au Lycée et finalement au Bac et à l’entrée en Université. Un travail assidu, main dans la main avec les élèves et les parents. Ensemble nous avons donné espoir à une vie meilleure aux Handicapés ; ensemble nous avons ouvert les portes et les fenêtres pour qu’ils soient acceptés partout et qu’ils aient droit au travail et une vie digne, heureuse.
( Ecole des Sourds de Mohamedia Ex-Lavigerie )
Les années du terrorisme aveugle ont donné une dimension encore plus profonde à cette vie partagée avec des personnes handicapées. En effet, comment expliquer aux élèves sourds que cette violence aveugle, que nous vivions dans toutes ces atrocités, ne venait pas de Dieu mais de l’intolérance des hommes de quel bord qu’ils soient. Combien de fois, dans cette période, dans mon lit le soir, que j’ai pleuré en revoyant devant moi ces images d’hommes, de femmes, d’enfants, de nos amis blessés ou assassinés brutalement sans aucune raison ! Même le traducteur en langue de signes pour les sourds à la Télévision fut tué. Ce sont les élèves, les voisins, les amis, parfois des passants, qui m’ont permis de passer avec le Peuple Algérien tout entier ces moments d’énorme détresse et de désespoir !
Combien de fois me reviennent, encore aujourd’hui, dans mon esprit cette immense foule de la région de Tizi-Ouzou, assistant aux obsèques des Pères assassinés, frappant dans les mains et en clamant des youyous pour exprimer leur solidarité dans le malheur et leur foi dans un même Dieu unique.
( ALGER : Ecole de formation paramédicale de Parnet )
Alger, le 2 avril 2011.
Jan HEUFT.
10:31 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook
Facebook
09/02/2012
Une expérience extraordinaire (Jan HEUFT) 1
Vivre ailleurs !
Un jour mémorable : le 21 septembre 1969 je passais la frontière d’Algérie avec ma petite Renault 4L pour y rester 42 ans, c'est-à-dire jusqu’aujourd’hui ! Cela fut une aventure hors pair. Tout d’abord cette rencontre avec des hommes et des femmes d’autre culture et d’autre religion ! Ces hommes et ces femmes, à peine libérés de plus de cent vingt ans d’oppression coloniale, debout pour construire un nouveau pays moderne et libre !
C’est ainsi que je débarquais, un soir, dans un profond brouillard, dans la cour du Collège des Pères Blancs à Ath Larbaa d’Ath Yenni. J’y fus accueilli par des jeunes hommes en burnous, tous des élèves d’environ 18 à 20 ans, en retard dans leurs études à cause de la guerre d'Indépendance, mais déterminés à devenir, comme ils disaient eux-mêmes : « devenir quelqu’un ». Jamais je n’oublierai leurs regards « d’hommes libres » déterminés à se prendre en charge. Dans un coin de la cour, il y avait ce jeune garçon de Timéghras ; dans son village, tous les hommes avaient été tués par l’armée coloniale sur la place publique ; malgré cela, ses parents l’avaient envoyé étudier dans notre collège, sans rancune. Il n’y avait pas de lois de réconciliation mais elle existait, belle et bien, dans la pratique.
J’y suis resté sept ans jusqu’à la nationalisation au mois de juin 1976. Sept ans de partage de vie journalière avec 140 élèves internes, qui ne partaient que rarement chez eux. Les seules distractions du lieu étaient les matches de handball sous la direction du célèbre Père Gayet, les films culturels obtenus à l’Ambassade de France, projetés par le Père Dieulangard et commentés, puis travaillés en classe par les jeunes enseignants coopérants. Il y avait également une bibliothèque très riche qui permettait aux uns et aux autres d’élargir leurs pensées et regards sur le monde. Ce climat d’étude et de travail intellectuel ne pouvait qu’être favorable à des résultats extraordinaires aux examens où nous obtenions 100 % (ou presque) de réussites. Mais ce qui a été peut-être encore plus important c’est d’avoir formé des hommes capables de vivre ensemble et de se mettre au service des autres.
Ce n’est pas sans regrets que j’ai quitté le Collège en octobre 76 pour me consacrer, à Rome, pendant deux ans, aux études de la Langue arabe et du Message coranique, mais en écoutant, toujours, pendant mes heures de recherches et les études, des cassettes de célèbres chansons d’Idir et d’Aït Menguellet ! Le pays m’avait marqué pour de bon !
… À suivre

Alger, le 2 avril 2011.
Jan HEUFT.
18:42 | Lien permanent | Commentaires (39) | ![]() Facebook
Facebook
31/01/2012
André LAUDE, Pied-rouge en Algérie (7)
On singeait Paris…
Si à Alger Républicain le vent soufflait en faveur d’un réalisme socialiste algérien dont les poèmes de Bachir Hadj Ali et de Boualem Khalfa, mettaient et mettent en évidence le pernicieux (point ne suffit « d’arabiser » Aragon et Eluard pour créer la culture algérienne socialiste) Mostefa Lacheraf, homme de culture universelle, conscience lucide et menant une vivante analyse critique des rapports entre culture et société, tentait de dégager des fondations saines. L’exemple des poètes et artistes cubains, la foi en un art qui fut à la fois témoignage et facteur d’émancipation mentale et d’émancipation sociale enflammaient la jeunesse intellectuelle qui, plus qu’à un Mohamed Dib ou un Mouloud Feraoun se référait à un Kateb Yacine, dont le génie libre, empêchait et empêche encore certains pinceurs de lyre officiels de dormir en paix sur leurs pauvres lauriers.
À Alger, c’était la course aux places. La vanité et les ambitions de certains éclataient au grand jour. Dans le petit monde des poètes et des peintres on singeait Paris, on rêvait de cocktails littéraires et de vernissages – on était charmant, bavard, confus, ennuyeux – Jean Sénac, ancien disciple de René Char, tentait d’organiser tout ce petit monde, futile et grave, sérieux et aliéné. « Pied-Noir dont les ancêtres étaient venus en Algérie il y a bien longtemps, poète dont le grand talent indéniable avait donné plusieurs recueils d’importance, enthousiaste et naïf comme seuls les poètes savent l’être, se voulant et se sentant profondément algérien, comme Camus, mais comme celui-ci séparé, Jean Sénac allait se fourvoyer dans des poètes « engagés ». Nous sommes nombreux encore à nous souvenir d’une certaine femme « belle comme un comité de gestion ». Révolution surréalo-surréaliste au Maghreb !
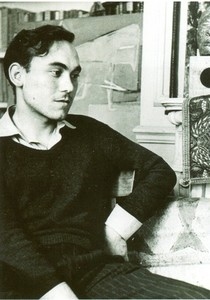
(Jean Sénac)
Dans ce milieu intellectuel un autre poète jouissait d’une certaine gloire : c’était et c’est encore car il n’est pas mort que je sache, Mohamed Aoun. Etait-il illuminé, était-il malin et rusé comme un fellah, toujours est-il qu’il paradait sur les boulevards d’Alger en uniforme de l’A.N.P. Les poches bourrées de poèmes où l’on retrouvait les souvenirs de lecture qu’un jeune homme sans doute autodidacte avait fait, pêle-mêle, lors de ses quelques séjours à Paris et à travers les livres rapportés. Mohamed Aoun chantait avec un lyrisme tonitruant et généreux les cataclysmes de la révolution. Rêvait-il d’être un nouveau Maïakovski maghrébin ? Il publiait dans El Djeïch, journal de l’armée nationale populaire. Il était la voix profonde du peuple, un peu prophète, un peu sorcier, un peu redresseur de torts, un peu comédien. On m’avait raconté que dans les désordres des lendemains de l’indépendance il s’était retrouvé aux postes de commande d’une des chaînes d’émissions de radio, dans le Sud. Il y fit des ravages. Chaque jour durant de longues heures, les fellahs pouvaient communier avec André Breton, Benjamin Perret, Tristan Tzara et… Mohamed Aoun. Quelque obscure conspiration mit bientôt fin à ces exploits. La révolution surréalo-surréaliste, comme la guerre de Troie n’aurait pas lieu.
Chez les peintres les choses paraissaient nettement plus sérieuses. Déjà une génération qu’il conviendra d’appeler la « génération de 54 » se mettait à l’ouvrage tandis que quelques aînés, entraînés par les perspectives exaltantes d’une révolution « des fellahs et des ouvriers » partaient à la quête d’une expression renouvelée. Ils trouvaient réconfort et espoir dans les déclarations publiques d’Ahmed Ben Bella qui faisaient écho aux « Paroles aux Intellectuels » de Fidel Castro, tenues à La Havane. Figuration, abstraction, rien n’était proscrit. L’art devait marcher parallèlement à la révolution sociale faite « par et pour le peuple » selon le slogan célèbre.
De son côté, le théâtre national algérien, dont l’acte de naissance avait été une curieuse adaptation de « En attendant Godot » cherchant sa voie entre Brecht et Lorca, fasciné par la réussite du T.N.P. mais freiné par des problèmes d’expression linguistique, le manque de répertoire en langue arabe répondant aux nécessités et aux données sociales psychologiques nouvelles. Kateb Yacine un des rares auteurs de théâtre algérien moderne, (bien qu’il écrive en français) avec le Cadavre encerclé et le Ravin de la femme sauvage, Kateb Yacine qui, après une longue errance à travers l’Europe, devait traverser en météore l’Algérie, s’y heurter à une maffia de petits intellectuels bureaucratiques, bien en place, avides de gloire, de prébendes, avant de repartir vers d’autres errances, ne reste qu’un cas solitaire et le théâtre algérien moderne est encore à naître. Son apparition et son existence dépendront non seulement de la présence d’auteurs mais aussi de la volonté réelle ou non des dirigeants d’arracher les masses algériennes à leurs ténèbres mentales, de combler ce fossé creusé par la colonisation, de leur capacité d’accepter ou non une culture libre, réellement révolutionnaire, de leur refus de répandre des sous-produits tout juste bons à la consommation du peuple, tels qu’en a fabriqués le stalinisme culturel, sous la houlette du camarade Jdanov.
André Laude
(Journal Combat 10 juin 1965)
09:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
25/01/2012
André LAUDE, Pied-rouge en Algérie (6)
L’étrange Soliman
Il n’était pas rare que vienne s’asseoir, au milieu d’un groupe, Annette Roger, la doctoresse de Marseille, l’ancienne militante des réseaux de soutien.
Comme chacun sait, là où ça barde, là où le coq de la révolution chante, il y a des trotskystes. Les trotskystes étaient donc à Alger, en la personne d’une poignée de militants actifs, dévoués et sincères. Un homme se détachait du groupe, Michel Raptis, plus célèbre sous le nom de Pablo, animateur de la Quatrième internationale et rédacteur de la revue du même nom dans laquelle il publia plusieurs textes consacrés à cette révolution dont il prenait la température, qu’il flairait avant de décider du soutien et de la publicité à lui apporter.
Je me souviens d’une de nos premières rencontres ans cet immense palais du gouvernement, non encore installé entièrement pour ses nouvelles fonctions. Dans un petit bureau orné d’un portrait d’Ahmed Ben Bella, Michel Raptis, grec d’origine et révolutionnaire de profession, me confiait d’une voix lente qui modelait les sons, ses espoirs, ses craintes. Il était rattaché au « Bureau national d’animation du secteur socialiste » (BNASS) où oeuvraient des Européens, frères ennemis (communistes orthodoxes et trotskystes) aux cotés de militants algériens d’avant-garde. Avec Révolution africaine, le BNASS fut un laboratoire de la révolution algérienne qui, s’il avait des amis, ne manquait pas non plus d’ennemis disposant de moyens et d’appuis. Au Berry encore on croisait Lotfallah Soliman, étrange personnage. Il était lié d’amitié avec Ben Bella qui l’avait ramené dans ses fourgons. Bourgeois d’origine, éditeur d’ouvrages marxistes au Caire, activité qui lui avait valu les foudres nassériennes, précédé d’une certaine légende, Soliman était un homme au regard inquiet caché derrière de grosses lunettes d’écailles. Symbole de « l’intellectuel de gauche », il me rappelait vaguement Arthur Miller (même calvitie, mêmes lunettes, même visage clos sur une pensée sans cesse en mouvement). Plus ou moins conseiller privé de Ben Bella, il devait publier quelques articles virulents où il pourfendait « El Ghoul », masque sous lequel se cachait à la première page du quotidien « Alger Républicain », organe non officiel d’un parti communiste alors dissous, l’auteur de La Question, Henry Alleg, petit bonhomme au crâne surmonté d’une petite houppette, pétulant de vie et d’humour, que j’étais sûr de rencontrer sur le coup de minuit au comptoir du bar, face à l’imprimerie, où les journalistes algériens pouvaient boire de la bière « sous le manteau ».
Les duels oratoires d’El Ghoul et de l’anthropophage (Soliman signait ainsi ses billets brûlants où l’écriture incendiaire ne cachait pas toujours la confusion de l’esprit) eurent leur heure de gloire au sein de l’intelligentsia à Alger. Bientôt Lotfallah Soliman allait prendre la direction des « Libraires du Tiers-Monde » dans les vitrines desquelles se côtoyaient Fanon et Marx, Rosa Luxembourg et Lénine, Daniel Guérin et René Dumont, les voix de l’Afrique et de Cuba, les portraits de Mao Tsé Toung et d’Ernesto « che » Guevara. C’était du moins, à ce niveau, le règne de la liberté de discussion et de critique la plus totale. Le Berry retentissait de discussions. A haute voix on légiférait et condamnait, tandis qu’un jeune homme, les yeux myopes derrière de fines lunettes, qui ne faisait pas son âge (il était grave, austère, et riait peu, songeait aux destinées de la culture algérienne. Mourad Bourboune, dont Julliard avait publié le premier livre « Le Mont des Genêts », poète et écrivain de talent, rongeait son frein dans son bureau froid de chef de cabinet du ministre de l’Economie, Bachir Bouzama, occupation qu’il abandonna bientôt pour les postes de Commissaire national à la culture, puis de président de la Commission culturelle du F.L.N., enfin de directeur d’El Moudjahid, l’organe central du Parti. Mourad Bourboune allait s’illustrer dans une mémorable discussion, au fil des numéros de Révolution africaine avec Mostefa Lacheraf, esprit scientifique, méthodique, homme chaleureux, discussion du plus haut intérêt puisqu’elle concernait le contenu et la forme d’une culture populaire révolutionnaire en Algérie, ses rapports avec le passé, l’héritage musulman et l’influence occidentale.
(Journal Combat 8 juin 1965)

08:59 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
19/01/2012
André LAUDE, Pied-rouge en Algérie (5)
Quand la révolution triomphait à la terrasse du Berry
En ces premiers mois de l’année 1963, en dépit des ombres inscrites au tableau, en dépit des faiblesses idéologiques du pouvoir révolutionnaire, conglomérat de diverses tendances contradictoires à propos desquelles mon ami Gérard Chaliand a écrit des pages pertinentes dans son ouvrage « l’Algérie est-elle socialiste » ? (éd. Maspéro), tout paraissait possible en Algérie. La révolution flottait dans l’air, les étudiants aux terrasses du « cercle Taïeb » et de la « Cafeteria » discutaient chaleureusement marxisme, culture révolutionnaire, Islam et nécessité des milices ouvrières.
Il y avait un autre haut-lieu de la révolution : le « Berry », situé en bas des escaliers de l’ex-Forum rebaptisé « Esplanade de l’Afrique », à peu de distance du port que le regard découvrait en contrebas, il était un peu une annexe de Révolution Africaine. Entre deux articles, on y venait se désaltérer, bière pour les européens et jus de fruits pour les frères algériens. Des projets prenaient forme dans le tumulte des allées et venues, le fracas des voix et la fumée des cigarettes. C’était le lieu de rendez-vous préféré de la petite colonie, turbulente et échauffée des « Français de gauche » qui avaient déserté Saint-Germain-des-Prés et les quais de la Seine, préférant aux charmes de Paris, capitale du royaume gaulliste, les charmes de la révolution, charmes auxquels venaient s’ajouter les plaisirs de la baignade quotidienne et du dépaysement. Au Berry, on était sûr de retrouver ce cher Georges Arnaud, le « français le plus anti-français » comme l’a baptisé « Minute ». L’auteur du « Salaire de la peur » avait trouvé place dans les services de l’information. Derrière son verre il tempêtait et pestait contre tel ou tel. Arnaud brûlait d’impatience, ses yeux profondément incrustés, cloués au fond d’orbites étroites, scintillaient, pétillaient d’intelligence, de malice. Il était bien l’homme de ses bouquins, charriant le sexe et le sang, l’or et l’excrément, tripes au soleil. Arnaud dressait sa révolution, la vivait intensément, en cherchait les traces sur les visages, le long d’un mur. Baroudeur, il se sentait à l’aise partout. Il appelait, si je puis m’exprimer ainsi, le feu de Dieu et le tonnerre de Brest. J’espère qu’il écrira tout cela un de ces jours, entre deux franches bordées, avec les copains.
Sa femme charmante et rieuse qui répondait, si ma mémoire est bonne, au doux surnom de « Quat’ Pattes » apparaissait parfois lorsque ses devoirs de mère, d’épouse et de combattante de la révolution lui laissaient quelque liberté.

Amar BENTOUMI et Jacques VERGÈS
Au Berry, on rencontrait aussi le doux Hervé Bourges, celui de Témoignage chrétien, pour qui le chemin de l’Algérie avait été un peu le chemin de Damas, un chemin de lumière. Bourges adorait la révolution algérienne, Ben Bella, les fellahs et les ouvriers, en bloc. À la terrasse du Berry venait parfois s’asseoir Jacques Vergès qu’avec malice nous appelions Mansour. En effet, sans doute pour s’intégrer plus à sa nouvelle patrie, Jacques Vergès avait arabisé son patronyme. Tout comme Maurice Maschino, l’auteur de Refus et de l’Engagement qu’on appelait plus que Tarik tandis que sa délicieuse épouse avait opté pour Fadéla.
(Combat du 10 juin 1965)
07:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook






