12/05/2014
Reconstruire le regard savant (François SIINO)
Au terme d’une première et rapide lecture transversale de ces sources mémorielles sur le temps de la coopération, il serait évidemment prématuré de prétendre tirer des conclusions ; il s’agit plutôt de souligner la richesse et le caractère ouvert d’un corpus qui invite à des analyses plus ciblées. Il faut aussi en souligner les manques, le plus criant étant sans doute – à ce stade – le trop faible nombre d’entretiens avec des témoins maghrébins de cette période. Leurs témoignages et leurs analyses sont pourtant une composante indispensable pour prolonger l’enquête et appréhender dans toute sa complexité la construction du champ intellectuel franco-maghrébin qui se dessine à cette époque.
Cette première lecture conduit néanmoins à s’interroger sur la pertinence de la catégorie même de « coopérant » pour réfléchir aux effets en retour de cette période. En d’autres termes, peut-on parler d’une génération de coopérants français au Maghreb au sens où Jean-François Sirinelli identifie une génération intellectuelle de la guerre d’Algérie (Sirinelli, 1999) ? Probablement pas, pour des raisons qui tiennent à la fois à la composition objective de l’ensemble d’individus que recouvre cette appellation et à la perception subjective que ceux-ci ont de leur existence collective.
On l’a dit au début de ces lignes, il s’agit d’une population composite, aux statuts divers, et dont l’expérience vécue a fortement varié du fait de la diversité des espaces concernés et surtout de la longue durée sur laquelle elle s’est déroulée. Parmi les rares témoignages écrits, il suffit de lire en parallèle celui d’un coopérant en poste en Tunisie dans les années 1960 (Fouchard, 2001) et ceux du « dernier coopérant français en Algérie » rentré en France en 1994 (Durand, 1997) pour mesurer la difficulté de comparer des parcours intervenus à trois décennies d’intervalle. De fait, si les récits écrits sur cette période sont si rares, ce n’est certainement pas du fait de l’oubli : les témoignages oraux recueillis au cours de cette enquête montrent au contraire la force et l’intensité des souvenirs, le désir d’en transmettre le contenu tout à la fois humain, intellectuel, émotionnel, politique… Mais il s’agit visiblement d’une mémoire qui ne s’inscrit pas spontanément dans un cadre collectif. Même si des contacts individuels ont pu être maintenus entre anciens coopérants universitaires, il n’existe apparemment à ce jour aucun regroupement de type associatif ou autre, se voulant porteur d’une identité et d’une mémoire commune[1].
Une autre raison de la difficulté à se penser en tant que groupe tient sans doute également à une contradiction inhérente au statut du coopérant et à la finalité de sa mission : en tant que membre d’un collectif censé contribuer à l’autonomie des pays assistés, celui-ci n’a en effet d’autre raison d’être que de travailler à sa propre disparition (c’est-à-dire son retour en France), d’autre horizon que d’acquérir la certitude d’être devenu inutile une fois remplacé. Il est donc plus facile, y compris sur le moment, de penser la coopération comme une expérience humaine et intellectuelle personnelle et singulière. Une telle posture permet, sinon d’aller jusqu’à envisager une installation définitive dans le pays – ce que plusieurs ont néanmoins fait –, du moins de ne pas fixer au séjour d’échéance précise. Et dans la plupart des cas, les raisons du retour tiennent moins au sentiment d’avoir rempli son contrat (et donc d’être devenu superflu), qu’à des considérations personnelles (familiales, universitaires, professionnelles).
Mais si le statut de coopérant n’a pas en tant que tel créé d’effet générationnel identifiable, les témoignages des jeunes intellectuels qui en ont fait l’expérience confirment néanmoins un fait majeur : le temps de la coopération a été l’une des matrices majeures de la formation de ceux qui allaient devenir dans les décennies suivantes, les spécialistes français du Maghreb, et plus largement du monde arabe. De ce point de vue, leur expérience est à rapprocher de tous ceux qui ont vécu une autre forme de coopération scientifique en animant, à la même époque et plus tard, les centres français de recherche dans le monde arabe (au Caire, à Beyrouth et Damas). Nombre d’entre eux ont d’ailleurs connu successivement les deux expériences, dans une série d’aller-retour entre la France, le Sud et l’Est de la Méditerranée. C’est de ce vivier que sont sortis la plupart de ceux qui ont occupé des fonctions de recherche et d’enseignement au sein d’institutions de recherche sur le monde arabe et musulman en France, qui les ont eux-mêmes parfois créées, et, à un moment où à un autre, les ont dirigées. Pour ne prendre qu’un seul exemple, l’historien André Raymond, coopérant en Tunisie (1957-59) a dirigé par la suite l’Institut Français d’Etudes Arabes de Damas (1969-75), fondé l’Institut de Recherches et d’Etudes du Monde Arabe et Musulman d’Aix-en-Provence dont il a été le premier directeur (1986-89). On voit ainsi comment le déplacement géographique de la coopération peut s’avérer le prélude de vocations dans lesquelles le contexte, l’engagement politique et les options épistémologiques se combinent pour produire des parcours intellectuels originaux.
Ce moment liminaire revêt aussi une importance particulière dans la mesure où la période de la coopération est aussi celle où se construit un nouveau regard sur la réalité des sociétés de l’Afrique du Nord. Celui qui prévalait au temps de la domination coloniale étant révolu, il convient d’en construire un autre, et c’est ce que contribuent à faire ces jeunes social scientists « de passage ». Ce regard se construit avec les ressources théoriques et pratiques des sciences sociales disponibles à l’époque, sur une expérience personnelle voire intime, et dans le cadre d’une vision du monde conditionnée par un contexte politique global. Ce renouvellement du regard revient à poser une question fondatrice de toute la démarche anthropologique, celle de l’altérité : qui est cet autre qu’on appelait auparavant « l’indigène » ou le « musulman » et quel rapport entretenons-nous avec lui ? Dans le contexte maghrébin, cette question se pose en des termes exacerbés, ceux de « l’altérité proche » (Colonna, 1991). Impossible en effet de ne pas tenir compte d’une évidente proximité : celle qui facilite les contacts, la communication, qui donne l’impression de l’entre-soi et de la connivence, mais qui rappelle aussi la pesanteur et l’aliénation culturelle due à la colonisation. Tout aussi impossible de ne pas sentir les barrières manifestes, les discontinuités culturelles, linguistiques, symboliques, les ruptures de communication lorsqu’elles interviennent. Selon que l’on choisit de voir certaines choses et d’être aveugle à d’autres, on pourra juger qu’une décolonisation réussie se mesure au degré d’identité que l’on a réussi à préserver ou bien, à l’inverse, à la quantité d’altérité que devaient récupérer les anciens colonisés pour devenir eux-mêmes. C’est en partie sur cette tension que s’est re-construit le regard savant sur le Maghreb – et plus généralement sur le monde arabe – dans les décennies qui ont suivi le temps de la coopération.
François Siino*
* CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence.
Récits de la coopération au Maghreb
Le temps de la coopération: sciences sociales et décolonisation au Maghreb.
Jean-Robert Henry, Jean Claude Vatin
KARTHALA Editions, 2012
[1]. Le seul site internet qui revendique cette vocation (http://cooperant.algerie.free.fr/) est visiblement l’expression d’une initiative individuelle et le caractère très limité de son contenu ne le distingue guère des sites personnels dans lesquels l’épisode de la coopération constitue une sous-partie.
07:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook




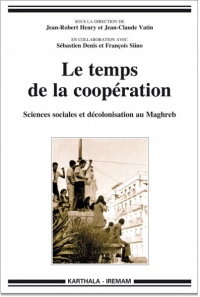
Les commentaires sont fermés.