21/10/2008
Les Français sont racistes selon Fadil
Voici le commentaire laissé par Fadil sur AgoraVox le 28 juin 2006 suite à l’article : Immigration choisie ou immigration subie ?
Salut ; je l’affirme les Français sont racistes vraiment et profondément tellement qu’ils ne le sentent plus. C’est ancré culturellement au plus profond.
De part ma situation familiale de mère libanaise et de père égyptien coopérant en Algérie et de part mon métier je suis informaticien + commercial
mais aussi du fait que j’ai grandi en Kabylie dans une région non arabophone et même anti arabe
j’ai été amené a voyager pour changer et pour vivre.
Je suis de ceux qui ont vécu et vu beaucoup de choses.
Le monde et la nature humaine, je crois connaitre un peu !!!
Le monde arabe, je l’ai sillonné de long en large.
Vous considérez le Maghreb comme un réservoir à émigrés qui ne sont là qu’à attendre un visa pour vivre dans la félicité en France.
Je vais vous surprendre peut-être !!
mais vous vous trompez très lourdement
Les choses changent et très vite !!!
plus vite que vous ne vous l’imaginez
en tout cas pour certains pays : Liban , Jordanie , Algérie , Dubaï
ceux-là, dans 10 ans tout au plus seront de l’autre côté c’est-à-dire du côté des pays riches vraiment riches.
Quant à l’émigration choisie faut pas se leurrer
les informaticiens (c’est mon métier) vous en avez au Maghreb
c’est très simple la perspective française n’a aucun intérêt vraiment aucun !
Je suis en France pour vendre des fichiers script fait à Alger ;
mes premiers clients ça a été des Canadiens.
J’ai tout vendu ; je suis content.
Je rentre à Alger ce soir parmi les miens
et les Canadiens et les autres, on se reverra l’année prochaine à Dubaï à Toronto …
partout ailleurs qu’en France !
Les choses changent, monsieur les choses changent
alors vos délibérations et vos certitudes !!!

10:24 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
03/10/2008
Ce que je dois à l’Algérie (Jean GALLAND)
...
Les événements sont venus à moi, mieux et plus vite que je ne pouvais l'imaginer. Nous étions tout juste installés à Tizi-Rached qu'a éclaté le coup de tonnerre du premier novembre 1954.
Quelques mois plus tard, la loi sur l'État d'urgence annulait la légalité, déjà si peu républicaine. Tout juste une semaine après la parution du texte au Journal Officiel, j'étais interdit de séjour, d’abord dans le département d'Alger, puis, quelques jours plus tard, dans le département d'Oran où je m'étais replié. J'allais donc passer le temps de la guerre dans mon Berry retrouvé, «La tête ici, le coeur là-bas» .
…
Faut-il ajouter que je me sens, aujourd'hui aussi fortement qu’hier, redevable à l'Algérie, au peuple algérien, d'une dette que je n’arriverai jamais â éponger et de liens que je ne chercherai jamais à trancher.
C’est en Algérie que ma femme et moi-même avons commencé à être adultes.
…
C'est en Algérie que s'est alors engagée et construite notre vie commune, que nous avons fait l'apprentissage d’être mari et femme, pour chacun de se réaliser soi-même non plus seul mais avec l'autre dont les aspirations, les goûts, les initiatives peuvent être contradictoires.
…
C'est en Algérie que sont nés trois de nos cinq enfants, les deux autres étant venues au monde en France bessif (par le sabre, par la force), la guerre nous ayant chassés de « là-bas », provisoirement. Nous avons eu alors la révélation de ce qu'il y a de puissant, de définitif dans le sentiment qui attache au sol natal. Ainsi de notre fait et pour toujours, Danielle serait de Djelfa, Jean-François d'Azzefoun, et Alain de Tizi-Ouzou !
C'est en Algérie, qu'en l'exerçant, j'ai appris mon métier d’enseignant, de maître d'école d'abord, puis de formateur après l’indépendance, tandis que la langue française ayant changé de statut dans des conditions totalement nouvelles, imprévues, il était fait appel à l'initiative, à l'intelligence, au courage de tous, afin d'être dignes des attentes d'une jeunesse tellement brimée, meurtrie par la guerre et avide de pouvoir enfin s'instruire et s'épanouir. Alors de 1962 à 1974, j'ai travaillé dans l'enthousiasme à la formation d’enseignants, de jeunes filles et de jeunes hommes, beaucoup rentrant de France, et qui choisissaient avec ce métier une place dans la société dont ils n'auraient pas eu le droit de rêver à l'époque coloniale. C'était exaltant et valorisant par la réflexion, qu'à tout moment il fallait exercer afin de décider des contenus et des méthodes qu’exigeait une situation assez difficile à définir. J'ai connu alors des relations humaines d'une qualité exceptionnelle dont certaines se prolongent encore aujourd'hui, un demi-siècle plus tard parfois avec les enfants ou les petits-enfants de mes amis de l'époque.
On me dira que j'idéalise, que nos cheminements ne manquaient pas d'embûches, voire même de pièges, sinon de véritables guets-apens. Comment dirais-je le contraire tellement je fus placé pour le savoir ! Il n'empêche que, pour cela comme pour bien d’autres choses de la vie, c'est au meilleur que l'on revient, le pire ayant glissé dans les oubliettes de la mémoire.
C'est à l'Algérie que je dois des souvenirs, des images, des parfums, des musiques, que je n'aurais connus nulle part ailleurs.
…
C’est en Algérie que j'ai éprouvé l'inestimable avantage et la fierté de fraterniser avec Bachir Hadj Ali, le chantre incomparable des luttes pour l'Indépendance.
…
C'est en Algérie que j'ai découvert l'immense richesse historique et culturelle de la communauté berbère, celle des Imazighen, les hommes libres, son organisation sociale sauvegardée malgré les siècles et les agressions, son orgueil légitime d'être ce qu’elle est grâce à ses racines et une identité incomparables, sa langue dont les bribes que je connais suffisent â me désoler de n'avoir pas su mieux l'apprendre lorsque je naviguais dans les « bains sonores » d’Akerrrou, Tizi-Rached, Azazga (ou toutefois, à ma défense, on avait toujours la courtoisie de parler français lorsque j'étais supposé prendre part à la conversation).
…
C'est en Algérie que nous avons rencontré une société féminine d'autant plus intéressante et attachante qu'elle différait à tous égards de la société de nos mères et de nos grands-mères.
…
Comment ne pas être humblement et amèrement admiratif devant ce qu'ont subi les femmes d'Algérie sous le régime colonial et peut-être surtout depuis un demi-siècle ?
Ces souvenirs, ces sentiments-là, font partie de notre vie pour toujours.
Nous avons compris en quittant l’Algérie en 1974 que nous serions désormais attachés à tout cela quoi qu’il arrive.
...
Jean GALLAND
Le cœur là-bas
Elles et Eux et l’Algérie
Éditions Tirésias, Paris, 2004
Pages 281 à 286
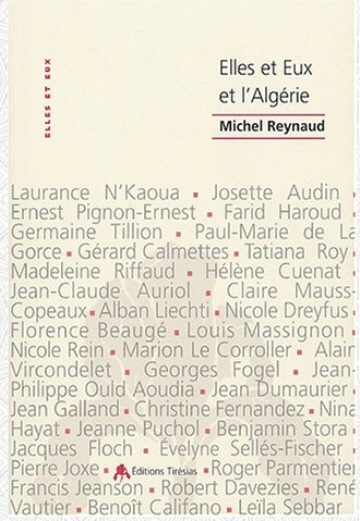
16:22 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
28/09/2008
Bernard CUBERTAFOND, de OUARGLA à PARIS 8
Notice biographique :
Bernard Cubertafond est professeur de droit public à Paris 8. Il a été, auparavant, assistant au Centre de formation administrative de Ouargla (Algérie), attaché de direction au Crédit Lyonnais (Paris), maître de conférences à l’université de Limoges, détaché prés l’ambassade de France à Rabat (attaché de coopération universitaire, scientifique et administrative) et professeur à Sciences-Po Grenoble.
Principaux ouvrages :
La République algérienne démocratique et populaire, PUF, 1979 ;
Contestations en pays islamiques, CHEAM- Documentation Française (en collaboration), 1984 ;
L’Algérie contemporaine, PUF, Que sais-je ? , Paris 4ème éd, 1999 ;
La Création du droit, Ellipses, Paris 1999 ;
Le Système politique marocain et La Vie politique au Maroc, L’Harmattan, 1997 et 2003.
Responsabilités à Paris 8
Mise sur pied du programme Tempus « gestion des universités » (programme retenu en 2004) avec un pool d’universités algériennes, et les universités de Louvain et de Turin. Animation du groupe d’études « droit post moderne ». Responsable du master « Etudes transdisciplinaires : relations euro - méditerranéennes, monde maghrébin » au sein de l’Institut Maghreb Europe. Président du jury de la maîtrise de droit public.
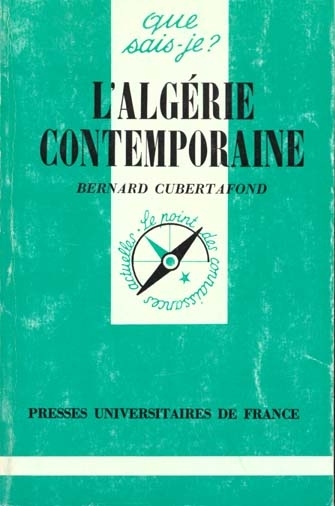
10:53 Publié dans 1-PREMIERS CONTACTS | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
21/09/2008
Bruno SCHENCK, cadre puis viticulteur
"Sur la porte de sa cave, à la craie, il a écrit des horaires où la sieste et l’apéro figurent en bonne place. Comme un clin d’oeil à sa vie d’avant. Une vie de cadre chez Renault, une vie où on parlait de moteurs, de culasses, et de centres d’usinage, mais aussi de plans de restructuration. Une vie où il a croisé des gens " extraordinaires ", affirme-t-il, ouvriers professionnels, contremaîtres, ingénieurs ou cadres. Une vie où il s’est " régalé ", un terme qu’il vous sert à tout bout de champ, mais où il craignait de ne rêver, à quarante ans, que d’une retraite anticipée. Alors Bruno Schenck a dit adieu à la Normandie et à l’usine de Cléon. Femme et enfants sous le bras, il est venu s’installer en pays cathare, dans le petit village de Padern, coincé entre rocher et rivière. C’est là qu’il a pris racine en cultivant sa vigne, en récoltant son vin - un corbières qui aujourd’hui se pose là - et en s’émerveillant chaque jour de travailler pour créer un produit destiné au plaisir. Bien sûr, les horaires affichés sur sa porte sont pure fantaisie. Bruno et sa femme travaillent sans répit, ne comptent pas leurs heures. Et le syndicaliste CGC qu’il était s’occupe aujourd’hui de syndicalisme d’appellation. Une autre vie. Un vrai… régal.
…
Nos mômes avaient huit et dix ans, c’était le bon âge, et nous ne pouvions pas en avoir d’autres. En plus, nous n’étions liés à rien matériellement. Alors, on s’est permis toutes les questions. Avec comme seule idée de choisir un autre style de vie, de changer d’horizon. En été 1987, nous avions découvert le village de Padern, près de Cucugnan, dans l’Aude. Tout ce qu’on aime. Du soleil, des cailloux, des arômes. En hiver 1989, nous y avons trouvé une maison. Il fallait au minimum un toit, il y avait quand même les enfants et on ne cherchait pas forcément à entrer dans une galère. On avait quelques économies grâce à deux ans de coopération en Algérie et à un départ de Renault qui s’est passé dans les meilleures conditions financières possibles. On pouvait voir venir.
Nous nous sommes installés ici en 1990. …
C’est vrai, la vigne, je n’y connaissais rien. Rien du tout. Mais ça a été très intéressant de découvrir tout ça. Et cohérent avec la formation que j’ai reçue, parce que le cadre se trouve toujours devant des situations nouvelles. Est-ce que c’est plus difficile de se lancer dans la vigne que de devenir, je ne sais pas moi, fabricant de toupies chinoises ? Bien sûr, nous avons fait des erreurs de néophytes, malgré une année de formation pour adultes qui nous a permis de décrocher le brevet professionnel agricole. Mais avec la pratique… Et puis, le gars qui nous a vendu son exploitation venait nous rejoindre chaque fois qu’on taillait les vignes. Il était content qu’un couple reprenne ses vignes. Notre apprentissage s’est fait petit à petit. Il y avait tout l’encadrement nécessaire sur place. Et sacrément compétent.
Notre première récolte ? C’était en 1992, une année d’inondations. De la flotte, de la flotte, de la flotte. Et j’avais un lumbago horrible, je pouvais à peine conduire. J’arrivais à la cave, je me couchais par terre, j’attendais qu’on me dise que le véhicule était prêt à repartir. Ma femme faisait tout le boulot. On avait tout ce qu’il fallait pour faire de belles vendanges… et on a eu toutes les mauvaises conditions. Mais on ne s’est pas dit " quand même, Renault c’était plus cool ". Depuis 1990, jamais, pas un seul jour nous n’avons regretté notre choix."
…
Propos recueillis par Florence Haguenauer
Article de L'Humanité du 14 juin 1999

14:20 Publié dans 1-PREMIERS CONTACTS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
14/09/2008
La liberté chez Philippe RAULET
Philippe RAULET nous a quittés brutalement en 2006.
À l’occasion d’un hommage qui lui fut rendu à La Roche-sur-Yon, au Grand R le 19 janvier 2008, Dominique Bondu nous a fait l’honneur et l’amitié de nous offrir ces mots pour se souvenir.
…
La liberté chez Philippe Raulet
Philippe Raulet a assumé toute sa vie la liberté qu’il avait décidé de se donner. Sans concessions. Il a compris très tôt, je crois, cette vérité sans fard, avec laquelle il n’est pas possible de tricher durablement : loin de se définir comme un droit que l’on peut revendiquer, la liberté est avant tout une condamnation faite à l’homme, à la fois nécessaire et sans recours possible. Pour qui veut se conduire dignement, il n’est pas possible d’y échapper. Cette leçon sartrienne, si mal comprise, Philippe en avait pris acte. Elle aura déterminé sa conduite d’homme et d’écrivain, ces deux aspects étant pour lui indissociablement mêlés – il a vécu comme écrivain, à la vie, à la mort.
Ainsi, ce fils de commerçants (ses parents étaient boulangers-pâtissiers-biscottiers) et petit-fils d’agriculteurs va commencer par faire des études de droit. Comme il était d’usage en effet chez la petite bourgeoisie provinciale, il fallait que le fils de la famille fût médecin ou, tout au moins, juriste. Ce déterminisme social, amorcé depuis la moitié du 19e siècle, aura ainsi marqué le destin de Gustave Flaubert : son père, Achille-Cléophas, médecin puis chirurgien à l’hôpital de Rouen voulait à tout prix que Gustave fasse du droit, à défaut de médecine. Et c’est sur le chemin de Rouen pour l’inscription à la Faculté de Droit, que Gustave fait une grave crise qui amènera son père à renoncer à toute ambition sociale pour son fils, ce dernier retrouvant ainsi une pleine liberté de détermination. Il y a en quelque sorte du Flaubert chez Philippe Raulet. Socialement déterminé pour être juriste, Philippe va passer sans passion sa licence de droit ; ensuite, il occupe un emploi durant trois années à la Bourse de Paris. Mais ceci est l’apparence sociale. « Gustave » Raulet se prépare à assumer sa liberté ; et il met ensuite fin à toute carrière professionnelle. Il décide de choisir la coopération en Algérie, ce qui lui permet de découvrir l’ailleurs ; libéré de ses obligations, il en profite pour voyager et fait le grand tour de la Méditerranée. De retour à Paris, il s’engage résolument dans l’écriture – la création littéraire : c’est à cette nécessité existentielle qu’il consent librement, en se dégageant de toutes autres contraintes.
À 26 ans, Philippe Raulet publie chez Gallimard, dans la prestigieuse collection « blanche » Napoléon V, un premier roman très remarqué. Le voilà promu jeune écrivain talentueux et prometteur. Il se trouve intronisé dans la scène littéraire parisienne – ce qui lui permettra de rencontrer Samuel Beckett.
Mais Philippe Raulet comprend très vite que les honneurs de la vie parisienne qu’on lui offre constituent un piège aliénant, qu’il va y perdre sa liberté et donc se perdre… Cette incroyable lucidité est véritablement étonnante de la part d’un jeune homme promis à tous les honneurs de la vie littéraire parisienne – nous sommes en 1966, la vie littéraire bat son plein, elle est encore auréolée d’un immense prestige social. En fait, cette lucidité du jeune écrivain situe parfaitement la hauteur de son exigence de liberté, Il prend alors la décision de fuir ce monde enivrant.
Philippe va se retirer en Lozère, sur le causse de Sauveterre. Loin de tout, dans cette splendide immensité déserte qui tient à distance de toutes mondanités. Il va y vivre une dizaine d’années. Sur le causse, il fait l’expérience de l’indépassable beauté de la nature sauvage, de son immensité qui excède la mesure de l’homme et qui en impose à toute volonté humaine. Cette extériorité radicale, devant laquelle l’humain doit abdiquer, et qui remet l’homme à sa juste place, le rappelle à sa juste mesure, constitue pour Philippe une leçon inestimable, consistant à remettre à sa place la prétention de l’artiste, du créateur. La beauté du causse l’empêchera d’écrire, me confiait-il un jour.
Il stoppe net toute « carrière » d’écrivain. Et presque trois décennies s’écouleront entre la parution de son premier roman en 1966 et celle du second véritable, MicMac, en 1993, chez Minuit, si l’on veut bien excepter la publication en 1987 chez Albin Michel d’un livre de commande sur Faust, un magnifique récit où il réinvente tout le mythe (Jean Faust, histoire d’un pacte, Albin Michel, 1987). Ainsi, c’est seulement en 1993 que paraît son second roman, Micmac, aux éditions de Minuit. Dans cet écart temporel considérable, ne voyons surtout pas l’illustration du syndrome bien connu du premier roman à succès, qui brise le ressort de l’auteur grisé, appelé à demeurer l’auteur d’un seul livre. Chez Philippe Raulet, la suite prouvera le contraire. Philippe est habité par l’écriture, il est porteur d’une œuvre immense qui se construira ensuite peu à peu avec une rare puissance.
Alors, que furent ces trois décennies silencieuses ? Eh bien ! des années de liberté. Intenses. Philippe Raulet n’a jamais confondu liberté et vacance, absence de cadre, refus de toute limite. Une œuvre va mûrir dans un esprit extrêmement bien organisé. Simplement refusant toute perspective de « faire carrière » au prix de toutes les compromissions, Philippe s’abstiendra de vouloir publier tant que la nécessité ne s’imposera pas à lui. Il vivra de divers petits boulots. Son origine rurale – il aura, gamin, participé aux travaux des champs – lui aura donné une solide constitution : petit, râblé, Philippe était une force de la nature, ce qui lui permettra de faire de durs travaux manuels.
Passionné par le lien entre écriture et oralité, Philippe travaillera également, durant toute cette période, avec des conteurs, des compagnies de théâtre et des radios, au gré des rencontres instauratrices.
…
Dominique BONDU

06:50 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook



