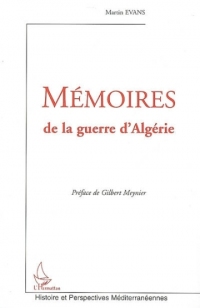01/05/2010
Bruno ETIENNE (Islamologue) tire sa révérence
Bruno ÉTIENNE, UNIVERSITAIRE ET SPÉCIALISTE DE L’ISLAM
Le politologue aixois Bruno Étienne est décédé le 4 mars 2009 des suites d’une longue maladie à l’âge de 72 ans. Ancien coopérant en Algérie, il a exercé la plus grande partie de sa carrière universitaire à la Faculté de droit et à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence qui lui doit, en grande partie, ses lettres de noblesse. Spécialiste du fait musulman en France et dans le monde, il fut l’auteur des premiers travaux sur l’islamisme radical et sur l’implantation de l’Islam dans l’Hexagone. C’est à lui que l’on doit notamment la popularité de la formule «Islam de France». Et selon l’Institut d’études politiques d’Aix, « il demeurera pour le monde universitaire un pionnier de la recherche pluridisciplinaire sur le phénomène religieux et plus particulièrement sur la dimension politique dans l’espace euro-méditerranéen ». Franc-maçon, membre du Grand-Orient, il prit des postions particulièrement courageuses sur la laïcité, en refusant de cautionner la stigmatisation du foulard islamique et son instrumentalisation politico-médiatique: « C’est aux jeunes filles voilées que l’on doit donner les palmes académiques et non au ministre qui les a exclues! », aimait-il répéter. De même, il critiqua à plusieurs reprises les «dérives» de la politique étrangère de la France, notamment lors de la première guerre du Golfe (1990-1991) qui, selon lui, ignorait la complexité du monde arabe (cf. son livre: Ils ont rasé la Mésopotamie: du droit de coloniser au devoir d’ingérence, Paris, Eshel, (2000). Enseignant passionné, ayant aussi enseigné en Tunisie, Egypte, Turquie, Syrie, Israël/Palestine, ainsi qu’aux Etats-Unis et au Japon, il a publié plus de 25 ouvrages au titre desquels nous retiendrons L’Islamisme radical (1987), et La France et l’Islam (1989). Il forma de très nombreux étudiants qui sont aujourd’hui parmi les meilleurs spécialistes du monde arabe et de l’Islam européen. Certains de ses ouvrages sont devenus des best-sellers: L’Islamisme radical, Paris, LGF, 1989 La France et l’Islam, Paris, Hachette, 1989 Abdelkader, Paris, Hachette, 1994 L’Islam en France, Paris, Cnrs Editions, 2000.
Une vie tournée vers le monde arabe
Bruno Étienne agrégé en sciences politiques était également diplômé d’arabe à l’Institut des langues Bourguiba (Tunis). Chercheur au Cnrs de 1962 à 1965, il a coopéré en Algérie de 1966 à 1974, puis après avoir passé son agrégation en France, il est devenu maître de conférences à l’université de Marrakech de 1977 à 1979. Rentré en France en 1980, il prend la direction jusqu’en 1985 du Centre de recherche et d’étude des sociétés musulmanes d’Aix puis intègre, comme professeur, l’IEP de la cité provençale. Connu pour son franc-parler volontiers, provocateur, ce protestant d’origine et franc-maçon déclaré, affilié au Grand-Orient depuis 1960, aimait lutter contre les stéréotypes. Il avait été consulté sur l’Islam par plusieurs ministres de l’Intérieur en charge des cultes. «C’est un des premiers à avoir envisagé d’étudier le religieux en sciences politiques comme tel, et à avoir compris que l’islamisme radical était un produit de l’Occident, un mouvement moderne et pas le cheminement normal de la tradition islamique», rapporte Raphaël Liogier, professeur à l’IEP d’Aix qui lui a succédé à la tête de l’Observatoire du religieux. Pour Franck Fregosi, directeur de recherches au Cnrs à l’université Robert Schuman de Strasbourg et enseignant à l’IEP d’Aix, Bruno Étienne fut « un professeur hors normes qui incitait ses élèves à poser les bonnes questions, celles qui dérangent ». Il travaillait sur le troisième volume de ses Anthropo-illogiques pour les éditions Odile Jacob. L’ouvrage sortira, assure son éditeur Alain-Jacques Lacot.
09:29 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
20/04/2010
Gilbert DESCOSSY, artiste et coopérant (2)
(suite)
Sur son faible pour l’Afrique du Nord, le professeur et éternel étudiant a toute une histoire à raconter. Cela remonte au bon vieux temps. Flash-back.
« En 2004-2005, je suis arrivé à Tunis pour apprendre l’arabe à Bourguiba-School. C’était juste après ma retraite. Mon dernier poste était dans une école parisienne. Le premier était à Caen alors que je n’avais que 21 ans. À 23 ans, j’ai été coopérant en Algérie. C’était à l’époque de Boumediene. Depuis, j’ai eu le coup de foudre pour le Maghreb. J’ai apprécié le brassage des cultures dans ces pays. Plus tard, je passais quasi tous mes Noëls au Maroc. En 1997, je me suis intéressé à la Tunisie. Il faut dire que j’ai découvert ce pays un peu plus tôt. En 1972, je suis resté un mois à Monastir où mon frère résidait. Lui aussi était comme moi coopérant dans l’enseignement. Quelque temps après, j’ai séjourné les trois mois des grandes vacances à Djerba », se souvient le Citoyen du monde (pour de vrai puisqu’il est en possession de cette carte symbole).
Puis le voilà de retour depuis six mois et cette fois-ci, pas comme touriste, mais pour changer sa manière de voir le pays en y vivant et pour le sentir. Mieux sentir les lumières qui ont captivé le regard de plus d’un artiste notamment Paul Klee. L’homme s’occupe aussi en bénévolat de tout ce qui touche à l’univers livresque. On peut le trouver dans la semaine soit à la bibliothèque de Carthage de Tunis soit à la bibliothèque du 9 rue Sidi Saber … Le reste de son temps, il le consacre à l’art. Il hume la pierre de notre histoire et s’imprègne de notre culture et écrit dans la langue d’El Moutanabbi.
À son âge, il se remet sur les bancs de l’école. Comme X temps quand il était dans la région de Perpignan, où il passait le plus clair de ses heures à dessiner. À Bourgoin Jallieu ( le pays du rugby ), il continue à donner libre cours à son imaginaire sans frontières. « C’est là-bas que j’ai eu de la chance d’avoir un instituteur qui était peintre et l‘un des premiers des fondateurs de la Société de Amis de Arts de la commune. Il m’a mis sur le bon chemin. À 13 ans, j’ai fait ma première expo et puisque je n’étais pas un bon élève, j’ai fait un raccourci. Après le brevet aux Beaux-Arts à Lyon, j’ai passé un concours sans avoir le Bac. C’est ainsi que j’ai intégré l’enseignement », raconte M.Gilbert qui aime de temps à autre s’exprimer en arabe tunisien, algérien et parfois avec un accent du Maroc. C’est ainsi qu’il sympathise avec les gens du pays et avec ceux qui ont besoin d’un coup de pouce. Lui, généreusement, il tend la main aussi à ses cadets sans compter. L’essentiel est de les aider à s’épanouir dans leur passion.

08:22 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
05/04/2010
S. MONTEVERDI et J-Y SANCHEZ au Département de Chimie
Serge MONTEVERDI et Jean-Yves SANCHEZ au Département de Chimie
L’émergence d’une communauté de chimistes
En 1962, les Algériens prennent possession de l’université coloniale. La politique de la terre brûlée a laissé ses empreintes : incendie de la bibliothèque de l’université, départ massif des enseignants européens qui animaient cette université. Les enseignements redémarrent grâce à la coopération internationale et aux premiers coopérants qui répondent à l’appel de l’Algérie, au titre de leur engagement politique. Dès la rentrée universitaire 1962-1963, à l’appel lancé par la nouvelle équipe dirigeante, le recrutement d’étudiants est massif. Mais il montre très vite une grande hétérogénéité des lieux comme des itinéraires de formation. Parmi eux, des expatriés, des militants dont les études avaient été interrompues par l’action politique, et ceux qui ont pu bénéficier de conditions spéciales, dérogatoires d’accès aux études supérieures.
Le redémarrage de la faculté des sciences d’Alger à l’indépendance
Faut-il rappeler ici que, du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, les Algériens étaient exclus des carrières scientifiques ? Ainsi, l’histoire de la faculté des sciences d’Alger, tout au long de la période coloniale, révèle une institution « dont le rôle réel est de reproduire des rapports de domination et dont les enseignements dispensés expriment les intérêts d’une classe dominante ». Dans ce contexte, on comprend aisément que des disciplines telles que la médecine ou le droit aient pu occuper une place et un rôle de premier plan. Les choses n’évolueront qu’avec l’indépendance.
En pratique, la faculté des sciences d’Alger reste, jusqu’au début des années 1970, dominée par la présence française tant institutionnelle qu’universitaire. Dans les premières années de l’indépendance, son premier doyen est le professeur François Dumontet. Puis, de 1964 à 1970, Rachid Touri, le premier Algérien agrégé en mathématiques avant l’indépendance, lui succède.
Au moment de l’indépendance, les enseignants de la faculté des sciences d’Alger, toutes disciplines confondues, sont, pour quelques-uns, des enseignants issus de familles « pieds-noirs » d’Algérie et qui y sont restées après 1962 ou des enseignants venus de l’ex-métropole. Parmi ces enseignants, des communistes qui avaient marqué leur engagement en faveur de l’indépendance de l’Algérie tel le professeur Robert Sauterey, normalien de la promotion 1943, et des chrétiens libéraux. Ici, le cas d’André Mandouze a valeur d’exemple. Universitaire, latiniste de renom, il est le premier directeur de l’enseignement supérieur en Algérie.
La création du département de chimie
Quelques changements institutionnels intervinrent dès les premières années de l’indépendance.
En 1966, un chimiste algérien, Ramdane Ouahes, arrive à Alger. Agrégé de l’École normale de la rue d’Ulm, il est, dès son retour, porté par ses collègues algériens pour succéder à Robert Sauterey à la tête de la chaire de chimie, avec l’idée d’une réorganisation institutionnelle de la chimie à l’Université. Un projet de création d’un véritable département de chimie à l’université d’Alger se profile. Étant le plus gradé parmi ses collègues algériens, Ramdane Ouahes prend la direction du département de chimie créé en 1964.
Après l’indépendance, plusieurs coopérants français arrivent à Alger pour renforcer la communauté naissante. On peut citer, par ordre alphabétique, des professeurs : Micheline Broust-Bournazel, Annie Diara, Valentin Hekanel ; des maîtres de conférences : Marc J. M. Abadie, Daniel Bodiot, Jean-Bernard Bourdet, Michel Daguenet, José Gayozo, Jean-Pierre Monthexerd, Louis Robert, Louis Schuffenecker, Bernard Spinnck, Jean-Maurice Vergnaud, Edgard Wendling ; des maîtres-assistants : Bernard Devallez, Michel Andriaux, André Pralloux, Robert Granger, Michel Leard, ainsi que des volontaires du service national actif (VSNA) tels Serge Monteverdi ou Jean-Yves Sanchez.
L’institutionnalisation d’un département de chimie et le renforcement de la communauté universitaire, parallèlement à la mise en oeuvre de l’accord franco-algérien de 1963, vont susciter, en 1965, la venue d’une deuxième vague d’étudiants algériens composée de physiciens, de chimistes, de mathématiciens, tous titulaires de thèses de troisième cycle. Ces étudiants, parmi lesquels on comptait des militants de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugema) étaient en majorité issus de l’université de Bordeaux alors que ceux de la première vague, qui a caractérisé l’année 1963, étaient partagés entre les universités de Besançon et Dijon. Parmi eux, on peut citer les noms de Abdelkader Kacher, Mustapha Bouhadef et Hakim Ladjouze. Les jeunes assistants qui ont assuré le démarrage de l’université à l’indépendance, en l’occurrence Mouloud Achour, M’hamed Meklati, Ouassini Benali-Baïtich, préparent, de leur côté, leur thèse.
De façon générale, la plupart des thèmes de recherche abordés relèvent davantage de la science fondamentale et servent plus particulièrement à l’organisation de formations supérieures spécialisées sans prise sur le secteur économique. Il faudra attendre la réforme qui touchera l’Université algérienne à partir de 1970 pour voir se profiler de nouvelles logiques académiques et la volonté manifeste des pouvoirs publics d’instaurer de nouveaux liens entre science et industrie.
Auditorium de l'Unversité de Bab-Ezzouar (Alger)
09:11 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
09/03/2010
Ania FRANCOS, auteur de « Un Algérien nommé Boumediène »
Ania FRANCOS , journaliste et romancière
Ania Francos vient au monde le 19 juillet 1938 à Paris où ses parents, juifs émigrés d'Europe de l'Est, se sont réfugiés. Sa mère, Shoshanah, est polonaise, native de Varsovie. Son père, Mordekhai, né à Tarnopol en Galicie, avait séjourné quelques années en Palestine avant de venir en France. Ania a quatre ans lorsque son père est arrêté par la milice, le 13 juillet 1942, du côté de Vierzon. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle trouvera son nom dans la liste des déportés à Auschwitz par le convoi du 17 juillet 1942.
Lorsqu'elle devient journaliste, Ania Francos collabore aux journaux engagés que sont Jeune Afrique, Le Nouvel Observateur, L'Autre Journal et Libération. Dans ses articles, elle défend les combats tiers-mondistes et les révolutions communistes de l'époque. En 1962, elle publie son premier ouvrage, La Fête Cubaine, essai sur la révolution dont elle avait rencontré le dirigeant Fidel Castro. Suivent des livres sur l'apartheid en Afrique du Sud, puis sur le combat des Palestiniens. La Blanche et la Rouge, son roman sur l'Algérie paraît deux ans après l'indépendance. Léna Eisenberg, l'héroïne juive de ce livre, ressemble fort à son auteure : journaliste comme Ania Francos, elle soutient comme elle les mouvements de libération des peuples. Le dernier ouvrage documentaire d'Ania Francos, Il était des femmes dans la Résistance, est récompensé en 1979 par le prix des lectrices de Elle.
Atteinte d'un cancer, Ania Francos le raconte avec ironie dans Sauve toi Lola en s'y travestissant à peine sous les traits d'une jeune avocate juive. Ce roman paru en 1983 est porté à l'écran par Michel Drach. Mais le courage et l'ironie d'Ania Francos ne suffisent pas à la sauver. Elle décède le 24 janvier 1988, laissant son fils Sélim orphelin.
Deux de ses confrères honorent sa mémoire dans Le Monde paru trois jours après sa mort. Jean Lacouture salue en elle la combattante : " Elle était cette République de Delacroix qui se dresse sur la barricade, offerte à tous les coups de l'histoire " ; tandis que Gilles Perrault rappelle qu'elle était née juive et que " sans être jamais allée à Auschwitz, elle n'en était jamais sortie et traînait l'incompréhensible remords de sa mort évitée. "
…
Bibliographie :
La Fête cubaine, Paris, Julliard, 1962.
La Blanche et la rouge, Paris, Julliard, 1964.
L'Afrique des Afrikaaners, Paris, Julliard, 1966.
Les Palestiniens, Paris, Julliard, 1969.
Un Algérien nommé Boumediène, Paris, Stock, 1976, en collaboration avec Jean-Pierre Séréni.
Il était des femmes dans la Résistance, Paris, Stock, 1978.
Sauve-toi Lola, Paris, Barrault, 1983.
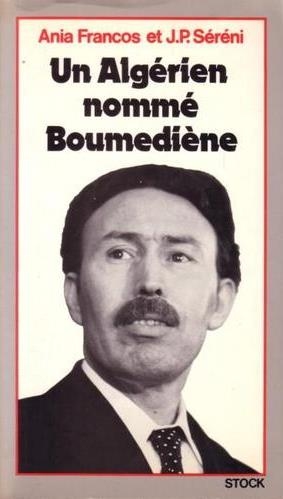
18:42 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
23/02/2010
Jean-Marie Boeglin, "Pied-Rouge" jusqu'en 1981
Jean-Marie Boeglin
Organisateur du Réseau de Lyon.
Né en 1928.
Dinard, 17 août 1989.
Les paroles de Jean-Marie Boeglin étaient calmes et mesurées. Il n'eut aucune hésitation à se rappeler ses motivations qu'il véhiculait avec passion et conviction. Les valeurs de la Résistance contre les nazis était le moteur principal de son opposition à la guerre d'Algérie et en ce sens il souhaitait souligner la dette qu'il avait envers son père, qui était suisse-allemand et avait travaillé comme garde-barrière. Son père avait de fortes convictions communistes et, durant l'Occupation, était un membre dirigeant du FTP à Châlons-sur-Marne. Comme il expliquait pourquoi à son fils, il insista sur le fait qu'il n'était pas animé d'un sentiment anti-allemand mais qu'il prenait parti dans le combat international contre le nazisme, et cette distinction marqua profondément Boeglin. Après la chute de la France en 1940, Jean-Marie Boeglin fut envoyé dans la zone non-occupée, ne retournant à Châlons-sur-Marne qu'en 1942 quand les nazis étendirent l'Occupation au reste de la France :
« Il est toujours difficile d'expliquer le sens d'un engagement quand c'est l'évidence. C'était aussi évident pour moi pendant l'Occupation, c'est-à-dire que ça n'a posé aucun problème, qu'au moment de l'engagement contre la Guerre d'Algérie, je crois que ça s'est passé de la mémo manière... une sorte d'évidence. C'est-à-dire que de toute cette période de l'Occupation, pour moi, il en ressort deux grands mots : liberté, parce qu'on était occupé, parce qu'il y avait une force d'oppression et de résistance. Et il y a peut-être mon côté d'être toujours contre, je e suis un peu anarchiste. J'ai toujours été contre de nombreuses choses, contre la société, contre les injustices. »
La Seconde Guerre mondiale fit de Boeglin un pacifiste et un anti-militariste. Il espérait beaucoup de la Libération et pensait que la France allait être transformée de manière fondamentale. Quand on demanda au FTP de rendre les armes, Boeglin se sentit trompé : il était convaincu qu'il s'agissait d'un geste calculé, destiné à étouffer la révolution populaire. Il s'en souvenait comme d'une expérience difficile qui représentait la fin de ses illusions. De même, il fut profondément choqué de découvrir les camps de concentration. Plus tard, il découvrit les atrocités perpétrées par l'armée française en Algérie et le parallèle avec les camps de concentration fut immédiat dans son esprit.
Ce qu'il voyait comme l'échec de la Libération fit de Boeglin un marginal. Vers la fin des années 40 et le début des années 50, il avait été anarchiste et surréaliste, et tout naturellement n'avait eu aucun désir de se conformer à la norme. Il exprimait sa colère envers la société au travers d'actes provocateurs en dynamitant les portes de prisons pour en libérer les occupants, ou en urinant du haut du clocher de l'église locale sur les fidèles qui étaient en dessous. La manière dont il fut en 1951 expulsé des Jeunesses Communistes pour avoir été trop anarchiste et de la Fédération Anarchiste pour avoir été trop marxiste montrait la mesure de son rejet instinctif de toute autorité.
C'est à travers la guerre d'Indochine que Boeglin prit conscience du problème algérien. Avant 1954, il n'avait pas réellement suivi l'évolution des événements en Algérie : deux incidents en particulier le rendirent plus attentif. Le premier fut le mouvement des réservistes qu'il couvrait comme journaliste pour l'Union de Reims. À Rouen, en septembre 1955, il fut témoin de la révolte des réservistes ; puis à Grenoble durant le printemps 1956, il vit des milliers de personnes essayer d'arrêter un train qui partait pour l'Algérie. Malgré l'ampleur des manifestations, se souvenait Boeglin, il n'en était jamais fait mention dans la presse. Ses articles étaient régulièrement censurés ou réduits au dixième de leur longueur initiale. C'est à partir de ce moment-là que Boeglin se plaça passionnément et intellectuellement contre la guerre d'Algérie. Le second événement qui le fit réellement prendre conscience de la situation fut l'enlèvement de Ben Bella en 1956. Parmi les personnes capturées avec Ben Bella se trouvait Mostefa Lacheraf que Boeglin avait rencontré plusieurs fois dans les bureaux de la rédaction des Temps Modernes à Paris Il savait que Lacheraf était d'un naturel doux, et non le dangereux terroriste dont parlaient les rapports officiels. Boeglin savait que ces rapports étaient falsifiés et refusait d'être manipulé. Il devint, à partir de ce moment, très attentif à ce qui se disait sur l'Algérie dans les médias.
Boeglin fut encouragé à entrer dans la clandestinité en raison du manque d'activité d'une certaine partie de la gauche au pouvoir. Pour lui, si le PCF avait réagi dans cette guerre comme il l'avait fait durant la guerre d'Indochine et avait encouragé les réservistes, les événements auraient été complètement différents. La position du PCF lui semblait dérisoire et il y voyait une trahison des principe. « En m’opposant à la guerre d'Algérie, j’ai agi par souci d'internationalisme... J'essayais de redonner un certain sens de l'internationalisme à la gauche française qui n'en avait pas du tout. »
En travaillant avec le FLN, le désir de Boeglin était de rompre avec le paternalisme de la gauche traditionnelle. Dans son esprit, la gauche au pouvoir n'était pas réellement anti-coloniale et elle se préoccupait par trop des limites de la légalité.
Au début de l'année 1957, Jean-Marie Boeglin commença à travailler avec Jean Planchon au Théâtre de la Cité à Villeurbanne. En 1957, à Grenoble, lors d'une présentation de son travail dans une école, il rencontra certains étudiants algériens. En parlant avec Boeglin, ils se rendirent compte qu'il soutenait leur cause et, quelques mois plus tard , un de ces étudiants vint rendre visite à Boeglin à Lyon pour lui expliquer comment un de ses amis avait été arrêté et torturé. Boeglin fut révulsé et répondit qu'il était prêt à l'aider s'il pouvait entrer en contact avec le FLN. Il n'eut jamais l'impression de faire quoi que ce soit d'illégal car, pour Boeglin, défendre les Algériens contre la torture relevait d'un acte instinctif.
Les méthodes utilisées par le FLN ne choquaient pas Boeglin. Il accueillit l'explosion de la raffinerie de pétrole de Mourepiane en août 1958 comme une stratégie acceptable. Boeglin fut très influencé par Frantz Fanon, qui était passé de l'anti-colonialisme au tiers-mondisme.
Après la guerre, Boeglin tourna le dos à l'Europe, alla vivre en Algérie et y resta jusqu'en 1981. Il croyait à la théorie selon laquelle la révolution allait se répandre de là à tout le continent africain.
Mémoires de la guerre d'Algérie
L’Harmattan
2008
10:14 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook
Facebook